
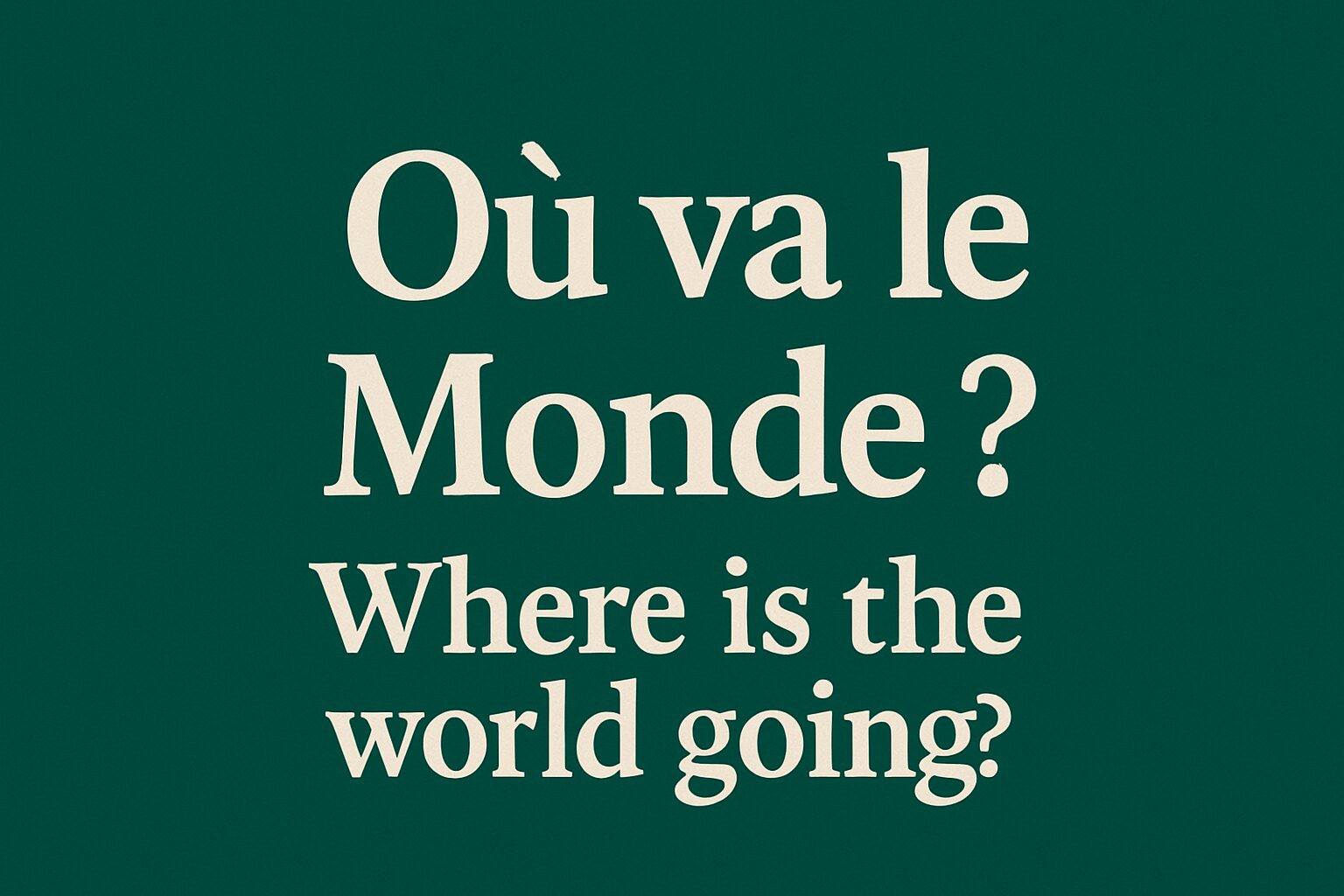
INTRODUCTION
Ce thème nous confronte à deux interrogations majeures :
- Comment se dessine et évolue l’ordre mondial sous l’effet des rivalités de puissance, de l’érosion du multilatéralisme, des transformations structurelles et de la polycrise qui affectent la gouvernance planétaire ?
- Et quel rôle l’Afrique peut-elle et doit-elle jouer face aux mutations en cours ?
Ces deux interrogations dépassent largement le cadre de l’actualité immédiate. Elles renvoient aux fondements mêmes de l’ordre international contemporain, aux impasses croissantes d’un multilatéralisme en crise, aux fractures systémiques qui traversent nos sociétés et aux recompositions géopolitiques en gestation. Elles appellent une réflexion prospective, où la lucidité analytique doit se conjuguer à une ambition politique éclairée.
La singularité du moment que nous traversons ne réside pas dans l’apparition de crises inhérentes à toute trajectoire historique mais dans leur conjonction simultanée, leur caractère structurel et leur profondeur systémique. Le monde est ainsi passé d’une succession de crises isolées à une polycrise permanente, nourrie par des ruptures multiples et interconnectées, qui désorganisent les équilibres établis et fragilisent l’architecture globale de la gouvernance planétaire.
Dès lors, il ne saurait être question de maintenir à tout prix un ordre ancien, dont l’iniquité, l’inefficacité et l’essoufflement sont patents. L’enjeu est d’oser penser, et surtout bâtir, les fondations d’un nouvel ordre mondial : plus juste dans sa conception, plus équitable dans sa représentation, plus durable dans ses finalités.
I. CONSTAT D’UN MONDE FRAGMENTÉ, SOUS TENSION, EN QUÊTE DE BOUSSOLE
A. Le monde en crise : vers une recomposition géopolitique globale
Les convulsions géopolitiques, économiques et sociétales des dernières années qu’il s’agisse de la guerre en Ukraine, de la montée des tensions en Asie orientale, ou encore des perturbations climatiques, énergétiques et migratoires traduisent moins des soubresauts conjoncturels que la recomposition profonde des équilibres du monde. L’histoire semble s’accélérer, fragmentant les certitudes d’hier et déstabilisant les piliers sur lesquels reposait l’ordre international d’après-guerre.
Ce désordre global s’exprime à travers une pluralité de lignes de fracture, qui rendent compte de l’instabilité du monde contemporain :
• Une fracture géopolitique, marquée par le retour des logiques d’affrontement entre puissances rivales, la résurgence de sphères d’influence, et une érosion manifeste des mécanismes de sécurité collective ;
• Une fracture économique, avec l’accentuation des inégalités structurelles entre le Nord et le Sud, dans un contexte de financiarisation croissante, de concentration des richesses, et de dissymétrie persistante dans les échanges ;
• Une fracture technologique, portée par la concentration des savoirs, des plateformes numériques et des chaînes de valeur dans les mains d’un oligopole d’acteurs globaux, érigeant l’intelligence artificielle, les données massives et les infrastructures critiques en nouveaux instruments de domination ;
• Une fracture écologique, dans laquelle les pays les plus vulnérables, notamment ceux d’Afrique, subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique, sans disposer des moyens d’adaptation ni accéder aux financements climat promis ;
• Une fracture migratoire, alimentée par les déséquilibres démographiques, les conflits, la précarité climatique et l’iniquité des régimes de mobilité, exacerbée par des politiques de fermeture et de stigmatisation dans les pays d’accueil ;
• Une fracture énergétique, où la transition vers des modèles durables se heurte aux intérêts géostratégiques, aux dépendances anciennes et aux nouvelles rivalités sur les ressources critiques ;
• Une fracture alimentaire, avec une vulnérabilité croissante des chaînes d’approvisionnement mondiales, une insécurité alimentaire aiguë dans de nombreuses régions du Sud, et un déséquilibre profond entre production, accès et souveraineté nutritionnelle ;
• Une fracture financière, illustrée par la persistance d’une crise de la dette dans nombre de pays en développement, piégés dans des cycles d’endettement insoutenables, aggravés par des conditions d’emprunt inéquitables et un accès restreint aux marchés internationaux ;
• Une fracture institutionnelle, enfin, où la crise du multilatéralisme revêt une acuité particulière. Elle se manifeste par l’essoufflement des forums de gouvernance mondiale, l’affaiblissement du droit international, la paralysie de l’ONU dans la gestion des conflits majeurs, et l’iniquité structurelle des institutions de Bretton Woods, dont l’architecture demeure largement tributaire des rapports de force hérités de l’après-Seconde Guerre mondiale.
Dans ce contexte fragmenté, le monde apparaît de plus en plus polycentrique, asynchrone et incertain, privé d’un socle normatif commun et d’une autorité stabilisatrice capable de faire prévaloir l’intérêt général. Le modèle libéral, longtemps présenté comme le destin naturel des sociétés modernes, est aujourd’hui ébranlé dans ses fondements non seulement par les puissances émergentes qui lui opposent des récits alternatifs, mais aussi par les impasses sociales, politiques et écologiques qu’il a lui-même engendrées.
Ce qui se joue, en filigrane, c’est une refonte du système international, tant dans ses normes que dans ses institutions. C’est une bataille pour la légitimité, pour la souveraineté cognitive et technologique, pour la justice économique et climatique. L’Afrique, si elle parvient à dépasser les logiques de dépendance, à penser le monde depuis ses propres ancrages, et à se constituer en force de proposition dans les débats globaux, peut y occuper une place singulière.
B. L’Afrique dans la tourmente mondiale : entre vulnérabilités et enjeux stratégiques
Dans ce paysage mondial en recomposition, l’Afrique se tient au carrefour des secousses du siècle, exposée de manière aiguë à la superposition des crises globales : crise climatique, crise migratoire, crise énergétique, crise alimentaire, crise de la dette, crise de la gouvernance mondiale. Elle est à la fois le miroir grossissant des vulnérabilités de l’ordre international et le théâtre d’un regain d’intérêts stratégiques, où se croisent les ambitions des anciennes puissances, les visées expansionnistes des émergents, et les injonctions contradictoires des institutions multilatérales.
Mais cette exposition accrue ne s’est pas traduite, jusqu’à présent, par un véritable renversement des asymétries de pouvoir. L’Afrique continue d’être l’un des continents les plus marginalisés dans les instances décisionnelles internationales, à commencer par le Conseil de sécurité des Nations unies ou les conseils d’administration des institutions de Bretton Woods, dont les règles de représentativité restent ancrées dans les rapports de force de l’après-guerre. Même lorsque le discours reconnaît le poids démographique, économique ou symbolique du continent, le pouvoir réel celui de fixer l’agenda, d’imposer des normes, de bloquer ou d’orienter les décisions lui échappe encore largement.
Ce paradoxe appelle une mutation des paradigmes. Il ne suffit plus d’être invité, visible, ou même célébré : l’enjeu est de devenir partie prenante. Il ne suffit plus de réagir ou de plaider ; il faut anticiper, structurer, construire et imposer une pensée stratégique autonome, qui affirme la légitimité africaine à participer à l’écriture du droit international, à redéfinir les priorités globales, à orienter les flux financiers, et à incarner une autre voie de développement.
Cette transformation implique trois ruptures fondamentales :
1. Rupture cognitive, d’abord : il s’agit de sortir du regard extérieur qui a longtemps façonné la place de l’Afrique dans le monde regard misérabiliste, compassionnel ou utilitariste pour imposer une vision propre, enracinée dans les réalités africaines, mais capable de parler au monde. Cela passe par une réhabilitation des savoirs endogènes, par l’émergence d’une pensée stratégique africaine, et par la conquête des espaces de production intellectuelle, scientifique et culturelle mondiaux.
2. Rupture institutionnelle, ensuite : le continent ne peut continuer à négocier morcelé, à parler d’une voix dissonante, ou à déléguer ses leviers d’influence à des acteurs extérieurs. Il lui faut renforcer ses institutions régionales et continentales, mutualiser ses capacités diplomatiques, et bâtir des coalitions de propositions, capables d’influencer les grandes négociations qu’il s’agisse du climat, de la dette, du commerce, ou de la gouvernance numérique. Cela suppose également une diplomatie plus agile, plus professionnelle, plus prospective.
3. Rupture éthique, enfin : pour être crédible, l’Afrique doit être exemplaire. Dans un monde en crise de confiance, les pays qui sauront allier intégrité interne et ambition externe, qui placeront l’intérêt collectif au-dessus des logiques clientélistes ou extractives, seront les mieux à même de s’imposer. Il faut que l’Afrique devienne non seulement audible, mais aussi désirable, en incarnant une autre manière de faire, d’exercer le pouvoir, de penser le futur.
Ce n’est qu’à cette condition que l’Afrique cessera d’être l’objet de discours sur l’avenir, pour devenir le sujet actif de son propre destin et un contributeur décisif à l’avenir du monde.
II. LES FRONTS PRINCIPAUX OÙ L’AFRIQUE DOIT S’AFFIRMER
A. Paix et sécurité : de la dépendance à l’appropriation
Dans un contexte marqué par l’essoufflement manifeste des dispositifs internationaux de sécurité souvent perçus comme désincarnés, inopérants ou empreints de logiques exogènes, l’Afrique ne peut plus déléguer sa stabilité à des mécanismes qui la contournent, l’infantilisent ou l’instrumentalisent. L’urgence commande une réorientation doctrinale profonde vers une architecture sécuritaire réellement africaine, fondée sur une lecture endogène des dynamiques de conflit, des ressorts de la réconciliation et des leviers de paix durable.
Cela implique, en premier lieu, le renforcement opérationnel, juridique et politique de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), dont les principes doivent être non seulement consolidés, mais incarnés par des capacités concrètes d’intervention, de médiation et de suivi. En second lieu, il convient de forger une doctrine africaine partagée du règlement des différends, avec les exigences contemporaines de légalité, de responsabilité et de droits humains.
Enfin, l’Afrique doit assumer une autonomie stratégique dans les processus de négociation et de sortie de crise. La marginalisation de l’Union africaine dans la gestion des conflits du continent au profit de formats parallèles, dictés par des puissances extérieures ou des coalitions informelles, doit inquiéter. Elle révèle l’impératif de rompre avec les réflexes d’assistanat sécuritaire, pour bâtir une gouvernance africaine de la paix, enracinée dans les traditions juridiques, philosophiques et politiques du continent, et capable de peser de manière souveraine sur l’agenda sécuritaire mondial.
B. Économie et finance : vers une souveraineté stratégique
Face à un ordre économique mondial largement hérité de l’après-guerre, dont les mécanismes perpétuent une hiérarchie inéquitable entre les nations, l’Afrique doit se positionner non comme requérante, mais comme co-architecte d’une refondation systémique. La crise multidimensionnelle actuelle offre un moment propice pour contester la légitimité des règles qui régissent aujourd’hui la dette, la notation du risque, les droits de tirage spéciaux et l’accès aux ressources de développement.
Cette refondation appelle, d’une part, une réforme structurelle des institutions de Bretton Woods, dont les instruments demeurent inadaptés aux défis spécifiques du continent. Elle requiert, d’autre part, une dénonciation claire et articulée des biais systémiques dans l’évaluation du risque souverain, lesquels pénalisent injustement les économies africaines, accentuent leur vulnérabilité, et les privent des capitaux nécessaires à leur transformation structurelle.
Il est crucial, à cet égard, de renforcer les institutions financières africaines, tant régionales que continentales, et d’accélérer la création d’agences de notation africaines indépendantes, capables d’offrir une lecture contextualisée, rigoureuse et équitable des trajectoires économiques nationales. Le plaidoyer fort réussi du Président Macky Sall pendant sa présidence de l’Union africaine, notamment son plaidoyer en faveur d’une réforme des Droits de tirage spéciaux, de l’inclusion de l’Afrique comme membre du G20 et d’un élargissement de la gouvernance des institutions financières internationales, constitue un jalon essentiel qu’il convient de transformer en dynamique collective. Car seule une mobilisation unie, cohérente et stratégique des États africains pourra infléchir les lignes de force d’un système économique profondément asymétrique.
C. Climat et justice environnementale : une cause existentielle
L’Afrique incarne à la fois la ligne de front de la catastrophe climatique et l’angle mort des décisions globales. Responsable de moins de 4 % des émissions cumulées de gaz à effet de serre, elle en subit pourtant les conséquences les plus extrêmes désertification accélérée, stress hydrique, insécurité alimentaire, déplacements massifs de populations. Cette injustice historique et structurelle impose une rupture radicale avec le statu quo des négociations climatiques.
Désormais, il ne s’agit plus de participer tardivement aux débats mondiaux, mais de prendre l’initiative et d’en redéfinir les termes. Ce combat suppose, en premier lieu, l’obtention de financements climatiques à la hauteur des besoins réels, libérés des conditionnalités opaques et des procédures paralysantes qui ralentissent les flux. En second lieu, des transferts technologiques équitables doivent être exigés, dans un cadre de partenariat, non de subordination.
Surtout, l’Afrique doit se projeter comme un acteur stratégique de la transition énergétique mondiale, en valorisant ses gisements solaires, hydrauliques et géothermiques pour bâtir une souveraineté énergétique verte. La Déclaration de Nairobi, en appelant à une fiscalité carbone mondiale plus juste et à des mécanismes innovants de financement, ouvre une voie qu’il faut désormais institutionnaliser, amplifier, et intégrer dans une vision climatique panafricaine, portée par des leaders unis, outillés et ambitieux.
D. Savoirs et souveraineté intellectuelle : le socle invisible
Aucune souveraineté réelle ne peut s’affirmer sans une assise intellectuelle solide, continue et décolonisée. Dans un monde où les récits façonnent autant que les rapports de force matériels, l’Afrique ne peut plus se contenter de consommer des normes, des catégories et des modèles forgés ailleurs. Elle doit devenir un centre de production de sens, un foyer de pensée, un espace de projection conceptuelle.
Cela commence par une réinvention profonde des politiques d’éducation, de recherche et de formation, qui ne sauraient se limiter à répondre aux injonctions du marché du travail global, mais doivent viser la capacitation civique, critique et stratégique des générations futures. L’enjeu est de forger non seulement des compétences, mais des consciences.
Il faut également inscrire le continent dans la fabrique des normes internationales, qu’elles soient juridiques, éthiques, technologiques ou culturelles. Cela passe par la mobilisation des diasporas intellectuelles, la revitalisation des universités africaines, et la construction d’espaces de savoirs pluriels où les sciences sociales critiques et les épistémologies alternatives africaines dialoguent et proposent.
Car penser est une forme de souveraineté, et celui qui ne pense pas pour lui-même sera pensé par d’autres. Investir dans les intelligences africaines, c’est non seulement répondre aux défis du siècle, mais y inscrire une parole africaine authentique, courageuse et contributive, capable de proposer au monde un nouvel humanisme, nourri de mémoire, de résistance et d’avenir.
CONCLUSION
En définitive, répondre à la question « Où va le monde ? » revient, en dernière instance, à sonder la part de maîtrise que l’humanité conserve sur son propre destin. Car le monde n’obéit pas à une fatalité aveugle : il va là où des volontés collectives, structurées et persistantes, le conduisent. Il reflète la somme des choix politiques, des inerties historiques, des rapports de force assumés ou subis, et des imaginaires projetés par ceux qui osent encore penser l’avenir.
Dès lors, la véritable interrogation n’est pas tant celle d’un futur abstrait que celle de notre place dans l’écriture de ce futur. À nous, Africains, de faire en sorte que l’histoire mondiale ne se fasse ni sans nous, ni contre nous. Car trop souvent, nous avons été situés au croisement des trajectoires imposées par d’autres, réduits au statut d’objets dans une narration dont nous ne détenions ni le script, ni la voix.
Refuser cette marginalité, c’est revendiquer une posture de sujet historique à part entière. C’est affirmer que nous ne sommes pas condamnés à l’assignation géopolitique, au rôle passif d’arbitre silencieux des conflits d’autrui, ou de spectateurs émus des grandes conférences internationales. Notre génération porte la responsabilité de rompre avec l’héritage de résignation, de revendiquer notre droit à influencer le cours des choses, à orienter les normes, à contribuer à l’architecture d’un monde plus juste, plus solidaire, plus durable.
Cela exige de passer du discours à la stratégie, de la présence à la puissance, de la participation à la proposition. L’Afrique n’a pas vocation à devenir le théâtre perpétuel des grandes rivalités mondiales : elle doit se hisser au rang d’acteur normatif, de pôle de stabilité, d’architecte de solutions globales.
La boussole du monde n’est pas figée. Encore faut-il que nous osions y inscrire notre cap, avec lucidité, constance et courage.
Le Carrefour des Savoirs incarne une ambition essentielle : celle d’un continent qui ne se contente plus de subir le monde, mais qui le pense, le questionne, le façonne. Il matérialise cette volonté de faire émerger, depuis l’Afrique, des espaces de réflexion à la hauteur des enjeux globaux, et de nourrir l’action publique par l’intelligence collective.
L’initiative portée par le Président Macky Sall, à travers sa fondation, mérite à cet égard d’être saluée. Elle se présente comme un trait d’union fécond entre la pensée et l’action, entre l’Afrique et le monde, entre la mémoire des combats passés et les stratégies pour les défis à venir.
Il convient également de rendre hommage à l’engagement du Ministre Oumar Demba Ba, dont la vision et la constance ont permis l’émergence de cette agora intellectuelle. C’est en de tels lieux, à la fois rigoureux et ouverts, que peuvent se dessiner les boussoles de demain celles d’une Afrique actrice de son destin, et contributrice d’un ordre mondial plus lucide et plus juste.
